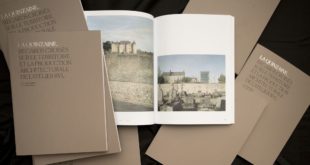Le sujet de ce livre est la France. Le but est de comprendre ce que ce mot désigne aujourd’hui et s’il est juste qu’il désigne quelque chose qui, par définition, n’existerait pas ailleurs. » Ainsi commence Le Dépaysement.
Ce qu’en dit l’éditeur
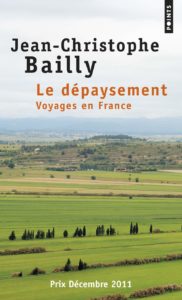 Mais pour répondre à cette question, à cette question d’identité, l’auteur, au lieu d’écrire un essai, a pendant trois ans parcouru le territoire, prélevant dans le paysage lui-même, sur le motif, les éléments d’une possible réponse. Les frontières, les rivières, les montagnes, les écarts entre nord et midi, mais aussi les couches de sédimentation de la conscience historique, ce sont tous ces éléments rencontrés en chemin qu’il restitue au sein d’un livre qui veut être avant tout la description d’un état de choses, à un moment donné. Cette « coupe mobile » fera donc passer le lecteur par une grande variété de lieux, des plus marqués par l’Histoire aux plus discrets, en même temps qu’il croisera quantité de noms et verra, mais sur pièces, se tendre les enjeux d’une question que l’actualité politique récente a fait resurgir, mais en la défigurant.
Mais pour répondre à cette question, à cette question d’identité, l’auteur, au lieu d’écrire un essai, a pendant trois ans parcouru le territoire, prélevant dans le paysage lui-même, sur le motif, les éléments d’une possible réponse. Les frontières, les rivières, les montagnes, les écarts entre nord et midi, mais aussi les couches de sédimentation de la conscience historique, ce sont tous ces éléments rencontrés en chemin qu’il restitue au sein d’un livre qui veut être avant tout la description d’un état de choses, à un moment donné. Cette « coupe mobile » fera donc passer le lecteur par une grande variété de lieux, des plus marqués par l’Histoire aux plus discrets, en même temps qu’il croisera quantité de noms et verra, mais sur pièces, se tendre les enjeux d’une question que l’actualité politique récente a fait resurgir, mais en la défigurant.
Extraits d’un entretien entre Sylviane Coyault et Jean-Christophe Bailly
Dans DIACRITIK – LE MAGAZINE QUI MET L’ACCENT SUR LA CULTURE, le 3 juin 2021, Sylviane Coyault (Professeur émérite de littérature française du vingtième siècle) s’entretient avec Jean-Christophe Bailly.
Dans Le Dépaysement, vous consacrez de belles pages à ces animaux domestiques qui font partie des paysages français : les moutons, les vaches, surtout. « Ils en sont le signe », dites-vous, « mais aussi les agents ». Domestique/ domus : dans cette maison commune, quel serait selon vous le risque de renoncer à la domestication (mutuelle de l’homme et de l’animal) ?
[…] Ce que j’évoque, et à quoi je tiens, c’est un paysage formé par et pour les animaux eux-mêmes, et c’est par conséquent celui d’une forme d’élevage qui fonctionne sur des relations qu’elle s’efforce de rendre plus actives : entre les hommes et les bêtes et entre eux tous et le monde où les formes de vie qui les structurent s’entretissent constamment. Pour citer à nouveau Ponge, quitte à employer ses mots dans un sens différent, la « fabrique du pré » est le résultat – non achevé – d’un processus très long, d’un très long et lent côtoiement. Renoncer aux prés clôturés, aux prairies et aux formes d’élevage dont ils sont le signe, ce serait en vérité donner un blanc-seing à l’élevage industriel, et ce serait aussi détruire cette relation ancestrale entre les hommes et les bêtes apparue avec le néolithique et qui a structuré non seulement nos paysages mais également nos mentalités. Il est important que quelque chose de la campagne demeure, et même revienne.Entre le respect que nous devons à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et la tradition végétarienne (Pythagore, l’hindouisme…) comment vous situez-vous par rapport à l’alimentation carnée ?
C’est une question très complexe et qu’il faut soustraire aux simplifications et aux positions dogmatiques, qu’il s’agisse de la posture consumériste-carnivore ou de la posture vegan. « S’il est loisible de manger chair » (cette formulation que je trouve juste et éclairante est celle d’Amyot traducteur de Plutarque), la question se pose à chaque instant, à chaque repas. Entrent en jeu ici des critères quantitatifs, liés à l’augmentation constante et irraisonnée de la population mondiale, et des critères moraux, liés aux formes d’administration du mourir. Comme le savaient tous les chasseurs-cueilleurs, tuer, c’est contracter une dette. Or cette dette est devenue énorme et impayée, exorbitante et nous en sommes là, hélas, même si l’alimentation carnée, en soi, n’est pas pour les hominiens de l’ordre du crime.
 L’auteur : Jean-Christophe Bailly est né en 1949 à Paris a longtemps dirigé la collection «Détroits» chez Christian Bourgois et une collection d’histoire de l’art chez Hazan. Il s’est occupé également de théâtre, à la fois comme auteur et comme «fabriquant», souvent à l’étranger (Inde, Russie, Italie) où il a accompagné Georges Lavaudant et Gilberte Tsaï ainsi que Klaus Michael Grüber et Gilles Aillaud. Outre ses pièces de théâtre, il a publié une vingtaine de livres. Avant tout des essais mais aussi deux fictions (récits plus que romans), un journal de voyage (en Inde), des poèmes et de nombreux articles parus dans différentes publications. Il est également l’auteur de monographies sur des artistes contemporains et, plus récemment, d’un essai sur les portraits du Fayoum. Auteur de nombreux récits, essais, poèmes ou encore pièces de théâtre, il croise les genres et couvre de nombreux domaines qu’il s’efforce de faire jouer entre eux. Enfin, il a longtemps enseigné l’histoire de la formation du paysage à l’ENSNP de Blois. Bref, Jean-Christophe Bailly est un auteur indéfinissable, à la croisée de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la philosophie et de la poésie. Il a notamment publié Le versant animal (Bayard, 2007), L’Atelier infini (Hazan, 2007), L’Instant et son ombre (Seuil, 2008), Le Dépaysement (Seuil, 2011) pour lequel il a reçu le prix Décembre, ainsi que Le Parti pris des animaux et La Phrase urbaine (Seuil, 2013).
L’auteur : Jean-Christophe Bailly est né en 1949 à Paris a longtemps dirigé la collection «Détroits» chez Christian Bourgois et une collection d’histoire de l’art chez Hazan. Il s’est occupé également de théâtre, à la fois comme auteur et comme «fabriquant», souvent à l’étranger (Inde, Russie, Italie) où il a accompagné Georges Lavaudant et Gilberte Tsaï ainsi que Klaus Michael Grüber et Gilles Aillaud. Outre ses pièces de théâtre, il a publié une vingtaine de livres. Avant tout des essais mais aussi deux fictions (récits plus que romans), un journal de voyage (en Inde), des poèmes et de nombreux articles parus dans différentes publications. Il est également l’auteur de monographies sur des artistes contemporains et, plus récemment, d’un essai sur les portraits du Fayoum. Auteur de nombreux récits, essais, poèmes ou encore pièces de théâtre, il croise les genres et couvre de nombreux domaines qu’il s’efforce de faire jouer entre eux. Enfin, il a longtemps enseigné l’histoire de la formation du paysage à l’ENSNP de Blois. Bref, Jean-Christophe Bailly est un auteur indéfinissable, à la croisée de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la philosophie et de la poésie. Il a notamment publié Le versant animal (Bayard, 2007), L’Atelier infini (Hazan, 2007), L’Instant et son ombre (Seuil, 2008), Le Dépaysement (Seuil, 2011) pour lequel il a reçu le prix Décembre, ainsi que Le Parti pris des animaux et La Phrase urbaine (Seuil, 2013).
Éditions du Seuil / Parution avril 2011
Édition Points / Poche – 20 septembre 2012
 Zone Franche Un site utilisant WordPress
Zone Franche Un site utilisant WordPress