Un récit de François Bon.
Prendre le même train une fois par semaine et décrire ce qui est vu par la fenêtre pour, en quelque sorte, promouvoir l’ordinaire, mieux le comprendre, et jusqu’à l’apprécier, tel est l’objectif que s’est fixé le regardeur François Bon.
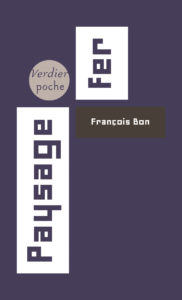 Ce qu’en dit l’éditeur
Ce qu’en dit l’éditeur
Tout un hiver, chaque jeudi, le train Paris-Nancy.
On suit la Marne, puis la Meuse et la Moselle.
Vieilles usines défaites, gares désertes, cimetières au pied des immeubles… Vient le temps des inondations, ensuite de la neige. De semaine en semaine, l’éclairage diminue, les villes s’allument.
La cimenterie, la boîte de nuit, c’est à Toul ou à Commercy ? À chaque trajet, de cette matière fascinante et profuse, on enrichit le détail par écrit, sans revenir sur l’état premier.
Travail du regard sur ces apparitions répétées, fragmentaires, discontinues, afin d’inscrire la réalité dans un espace recréé jusqu’à ce que forme et construction l’emportent sur le chaos de la vision – beauté arrachée à un paysage dévasté pourtant tellement riche d’humanité.
Ce qu’on en dit dans la presse
Pour mieux comprendre ce voyage entre Paris et Nancy à la vitesse du train, peut-être faut-il commencer par lire ce qu’écrivait Jean-Baptiste Hareng en janvier 2000 dans Libération à propos de Paysage fer : “François Bon note, note tout, un carnet ouvert sur les genoux, à la vitesse du train, sans composer, sans retour en arrière, mais le train va plus vite que le regard, plus vite que la main sur la page, plus vite que le mystère qui transforme les images en mots, il écrit modestement, page 29 :« cette fois-là, voilà, on n’aura noté que ça », ou dix pages plus loin : « on s’en veut de n’avoir pas plus retenu », avec le droit, le devoir, l’espoir et peut-être l’obsession sportive du voyeur éclaboussé d’images trop brèves, qu’il fera mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, il fait mieux, il se prépare, il attend tel virage, telle sortie de tunnel pour recompter les fenêtres de telle maison. Bientôt il se surprend à anticiper ce voyage de routine sur une carte (Michelin 241,30 francs, gare de l’Est), recopie les noms des villages sans gare et que rien n’indique au voyageur du fer, les reconnaît sur le terrain. Et finit par emporter avec lui une carte d’état-major au 25 000e comme si seul l’écrit pouvait donner foi au réel. Il y recopie la liste des toponymes que le paysage lui cache. Se rassure en prenant quelques photographies.”
De son côté, Nathalie Crom dans La Croix en janvier 2000 écrit : “Cinq mois durant, François Bon a été contraint d’emprunter chaque semaine le train Paris-Nancy. Cinq mois durant, il s’est contraint à regarder défiler le monde à travers la même fenêtre du même wagon. Et là où Vialatte conseillait au voyageur de toujours s’asseoir dans le sens inverse de la marche du train, pour laisser au paysage le temps de se dévoiler lentement à ses yeux, Bon choisit de le recevoir de face, de plein fouet. Soit « trois heures d’impressions rétiniennes continues avec villes, paysages et usines, maisons, immeubles, cimetières, et casses pour le fer, et canaux, et rivières et les longs ralentissements d’entrée de ville, quand on vous laisse enfin le temps de voir mais que la profusion elle aussi augmente et vous déborde… ». […] Au fil des voyages, le regard dissèque, s’oblige à se fixer sur tel ou tel détail, et apprend peu à peu à anticiper, à se repérer. Pourquoi cette obstination ? Peut-être simplement pour avoir « l’illusion d’un monde dont on est le provisoire voyageur d’une intimité par l’arrière offerte », pour vivre « le vieux rêve d’une proximité de la représentation mentale aux choses » et « comprendre un peu de son destin propre par la force qu’ont les choses ». Et pour finalement ressentir « l’imbrication, jusqu’à l’herbe, l’eau et même l’air au linge qui sèche un peu en arrière, dans l’enclos grillagé séparé avec cabane qui est forcément le jardin potager de la maison, de la chose humaine et des choses tout court », écrit Bon à la fin de ce très beau texte. Le monde à portée de main, dès lors qu’il est à portée de mots.”
“Paysage fer n’est pas un roman, et pourtant ce livre raconte bel et bien une histoire, des souvenirs, des repères, comme une mémoire collective et tellement personnelle” écrit justement Christine Ferniot dans Télérama en novembre 2014 ; elle ajoute : “quatorze ans plus tard, ce récit garde la même force de captation, de splendide ressassement, de tension permanente entre la phrase et le regard. Durant cinq mois, l’écrivain emprunta chaque semaine le même train, regardant défiler des images à travers la fenêtre”.
Cet ouvrage a reçu le Prix France Culture / revue Urbanisme « La ville à lire » 2000.
Édité chez Verdier – janvier 2000, puis réédité chez Verdier/poche – octobre 2014
 Zone Franche Un site utilisant WordPress
Zone Franche Un site utilisant WordPress



